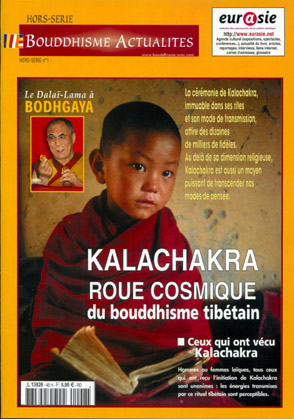Que sait-on de ? La Soka Gakkai par l'UNADFI
Posté : 10 nov.20, 05:28
Union nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes
Publié le 22 août 2014
La Soka Gakkai a été fondée au Japon dans les années 30 en tant qu’association de laïcs de l’école bouddhique Nichiren Soshu dont elle a, depuis, été excommuniée. Présidée par Daisaku Ikéda, la Soka Gakkai Internationale (SGI) est aujourd’hui une organisation riche et puissante. Présente dans 190 pays, elle compte plus de 10 millions d’adeptes, dont 6.000 en France où elle est implantée depuis 1966.
En 1930, quelques hommes d’affaires japonais pratiquant le boudddhisme de la Nichiren Soshu, une école bouddhique s’inspirant de Nichiren Daishonin, moine bouddhiste japonais du XIIIe siècle, fondent une organisation laïque, la Soka Gakkai. Au Japon, après la seconde guerre mondiale, la Soka Gakkai devient rapidement une véritable puissance et s’internationalise, surtout sous la présidence de Daisaku Ikeda (à partir de 1960). L’organisation va aussi s’impliquer dans la vie politique japonaise en créant, en 1964, un parti politique, le Komeito, qui, malgré une séparation officielle en 1974, est toujours soutenu et contrôlé par la Soka Gakkai. En 1991, cette dernière est excommuniée de la Nichiren Soshu.
A l’origine, la doctrine de la Soka Gakkai s’appuie sur la dévotion au sutra du lotus dont Nichiren Daishonin avait fait un commentaire : le Gosho. Les dirigeants actuels de la Soka Gakkai ont également fait une interprétation personnelle du gosho et aujourd’hui, ce sont ces textes, signés par Daisaku Ikeda, qui sont la référence pour les millions d’adeptes du groupe.
Les rituels sont organisés autour d’un objet de grande vénération : le Gohonzo, réplique du parchemin écrit par Nichiren Daishonin lui-même. Il est remis à chaque adepte qui le place chez lui, sur un petit autel de bois (butsudan). Deux rituels quotidiens de récitation rythment la vie des adeptes. Ils y consacrent environ trois quarts d’heure matin et soir, parfois plus, s’ils ont des problèmes particuliers à résoudre.
A cela s’ajoute la participation régulière, tous les quinze jours, aux Zadankai (réunions de quartier) qui comportent prière, étude des textes et échange d’expériences de vie. Ces différentes pratiques auraient des effets bénéfiques directs sur la vie des adeptes. C’est ce que la Soka Gakkai nomme « la preuve actuelle ». La prière entraîne, si elle est pratiquée correctement, la réalisation des désirs terrestres de l’adepte (matériels, financiers, sentimentaux) et l’absence de réussite concrète est due à une mauvaise pratique.
Le prosélytisme (Kosen Rufu) est le premier devoir du pratiquant car il permet de s’assurer que sa foi est authentique. Il transmet la loi correcte et aide ainsi à sauver le monde. Il est donc plus bénéfique pour le karma individuel que ne l’est la prière.
De nombreux adeptes se marient au sein du groupe. « Former un couple pour Kozen Rufu », signifie que la cellule familiale sert de relais pour la propagation de la doctrine. Un couple qui vit et éduque ses enfants selon les principes de la Soka Gakkai serait la clé d’une vie familiale réussie.
Les principes du groupe sont inculqués aux enfants dès leur plus jeune âge. Pour Daisaku Ikeda, « l’idéal est d’élever les enfants pour qu’ils chérissent notre organisation. Avec cet esprit, ils se développeront remarquablement.» Ils doivent également participer à l’action de prosélytisme . Dans cette optique, la Soka Gakkai a créé des départements jeunesse pour les former au « Kozen Rufu ».
Sur le plan politique, le but de la Soka Gakkai est d’instaurer une paix mondiale, et le chemin proposé pour y accéder est l’acceptation du bouddhisme de Nichiren Soshu par toute la planète. L’établissement d’une religion mondiale servant de base spirituelle permettrait d’aboutir à la création d’un état mondial idéal.
La paix dans le monde est l’un des thèmes de base de la campagne de communication mise en place par la Soka Gakkai dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale. Afin de cultiver cette image, elle s’appuie sur l’ONU dont elle est une ONG, comme d’autres grands mouvements sectaires, et elle finance des projets culturels et éducatifs.
Daisaku Ikeda a également rencontré de nombreux chefs d’états, ce qui lui sert de caution et le pare d’une aura d’honorabilité et de respectabilité auprès du public et des adeptes.
Riche et puissante, la Soka Gakkai tire une partie importante de ses revenus des dons. Les autres ressources sont d’origine commerciale: presse, vente d’objets de culte, de concessions et de monuments funéraires…
J'ai mis en gras tout ce qui peut détonner.
Commentaire :
Le Bouddha a dit clairement que : les prières sont vaines, les rituels inutiles, que la recherche de la prospérité matérielle en ce monde pour elle même ne peut mener à un bonheur profond et durable.
Le Bouddha s'est aussi opposé au culte de sa personne, puisqu'il a conclu son existence terrestre en disant : prenez refuge en vous-même. Donc l'ultime refuge ne peut être que l'introspection, c'est par elle qu'on atteint le but fixé par le bouddhisme, non dans la dévotion a un objet extérieur.
Et le Bouddha n'exhausse pas les prières. Ce n'est pas un dieu.
Le Bouddha refusa aussi toute fonction politique, ne créa aucun parti politique, et encouragea à questionner ses propres enseignements, à ne surtout pas le considérer comme vérité absolue comme émanant de Lui. Le Bouddha a aussi dit que l'examen personnel, l'expérimentation personnelle de ce qui est correct car menant et bonheur et incorrect car menant à la souffrance, devait primé sur tout texte fut-il sacré ou de réputation sacrée.
Le bouddhisme fut missionnaire (a partir de l’empereur Ashoka) mais jamais prosélyte. Le Bouddha n'a jamais dit qu'un pratiquant gagnait quoi que ce soit à faire des convertis. En toute logique une telle attitude - le prosélytisme - ne peut que renforcer le "Moi", l'illusion du "Moi", par de l'auto-satisfaction, de la fierté, de l'orgueil....
Le Bouddha durant sa vie (et il est le modèle de tout bouddhiste) évita consciencieusement et sciemment certaines régions et villes car il savait qu'il serait mal reçu car la population locale était trop attachée au brahmanisme. Il n'allait pas au devant des gens pour critiquer leurs doctrines mais les laissait venir à eux et répondait à leurs questions. Ce qui est le contraire même d'une attitude prosélyte.
Dans une pratique correcte du Dharma du Bouddha l'on commence par l'expérimentation sincère, on teste et c'est en vérifiant l'efficacité de la méthode du Bouddha parce qu'on gagne en bonheur dans la vie, qu'on peut alors développer la "foi" en le Bouddha, foi étant ici compris dans le sens de confiance. Ce qui est logique. Plus l'on peut vérifier par soi même que ce que quelqu'un vous dit est vrai, plus l'on a confiance en ce qu'il dit. Donc placer la foi (aveugle ?) en premier est en contradiction avec l'état d'esprit d'un pratiquant du Dharma du Bouddha.
Et le Bouddha ne récompensa jamais ses fidèles quand ceux-ci ramenaient de nouveaux fidèles. Le Bouddha ayant déjà tout ce qu'il était possible de souhaiter, il n'y gagnait rien.
Le Bouddha à ma connaissance n'a jamais non plus encouragé à se marier entre pratiquants de sa voie. Un pratiquant correct ne doit justement chérir personne en particulier ! Et surement pas une organisation financière et politique. Un pratiquant correct doit développer un amour et une compassion égale pour tous les êtres sensibles peu importe leur sexe, leur couleur de peau, leur religion, leur orientation politique, etc...
Le Bouddha n'a jamais utilisé d'enfant pour convertir autrui.
Ce qui a le plus servi au Bouddha fut sa propre attitude vertueuse. Il entendait être l'exemple parfait vivant de ce qu'il conseillait de faire.
En son temps l'empereur indien Ashoka développa pour la 1ère fois de l'histoire une sorte de bouddhisme d'état, tout en étant tolérant avec les autres traditions religieuses locales. Il fut très actif en faveur du bouddhisme. Tellement qu'après sa mort, il y eu un retour de bâton des brahmanes.
Le Bouddha refusa tout paiement en échange de son enseignement. Il le donnait à qui voulait l'entendre et acceptait parfois des dons quand on lui en faisait. Surtout des terrains pour sa communauté, des édifices légers pour se protéger pendant la saison des pluies , ainsi que des robes pour ses moines. Des dons en nourriture aussi forcément puisqu'il vivait en totale dépendance du bon vouloir des gens.
Tout ce qui est dit ci dessus est vérifiable dans des sources correctes de la part d'auteurs compétents.
Publié le 22 août 2014
La Soka Gakkai a été fondée au Japon dans les années 30 en tant qu’association de laïcs de l’école bouddhique Nichiren Soshu dont elle a, depuis, été excommuniée. Présidée par Daisaku Ikéda, la Soka Gakkai Internationale (SGI) est aujourd’hui une organisation riche et puissante. Présente dans 190 pays, elle compte plus de 10 millions d’adeptes, dont 6.000 en France où elle est implantée depuis 1966.
En 1930, quelques hommes d’affaires japonais pratiquant le boudddhisme de la Nichiren Soshu, une école bouddhique s’inspirant de Nichiren Daishonin, moine bouddhiste japonais du XIIIe siècle, fondent une organisation laïque, la Soka Gakkai. Au Japon, après la seconde guerre mondiale, la Soka Gakkai devient rapidement une véritable puissance et s’internationalise, surtout sous la présidence de Daisaku Ikeda (à partir de 1960). L’organisation va aussi s’impliquer dans la vie politique japonaise en créant, en 1964, un parti politique, le Komeito, qui, malgré une séparation officielle en 1974, est toujours soutenu et contrôlé par la Soka Gakkai. En 1991, cette dernière est excommuniée de la Nichiren Soshu.
A l’origine, la doctrine de la Soka Gakkai s’appuie sur la dévotion au sutra du lotus dont Nichiren Daishonin avait fait un commentaire : le Gosho. Les dirigeants actuels de la Soka Gakkai ont également fait une interprétation personnelle du gosho et aujourd’hui, ce sont ces textes, signés par Daisaku Ikeda, qui sont la référence pour les millions d’adeptes du groupe.
Les rituels sont organisés autour d’un objet de grande vénération : le Gohonzo, réplique du parchemin écrit par Nichiren Daishonin lui-même. Il est remis à chaque adepte qui le place chez lui, sur un petit autel de bois (butsudan). Deux rituels quotidiens de récitation rythment la vie des adeptes. Ils y consacrent environ trois quarts d’heure matin et soir, parfois plus, s’ils ont des problèmes particuliers à résoudre.
A cela s’ajoute la participation régulière, tous les quinze jours, aux Zadankai (réunions de quartier) qui comportent prière, étude des textes et échange d’expériences de vie. Ces différentes pratiques auraient des effets bénéfiques directs sur la vie des adeptes. C’est ce que la Soka Gakkai nomme « la preuve actuelle ». La prière entraîne, si elle est pratiquée correctement, la réalisation des désirs terrestres de l’adepte (matériels, financiers, sentimentaux) et l’absence de réussite concrète est due à une mauvaise pratique.
Le prosélytisme (Kosen Rufu) est le premier devoir du pratiquant car il permet de s’assurer que sa foi est authentique. Il transmet la loi correcte et aide ainsi à sauver le monde. Il est donc plus bénéfique pour le karma individuel que ne l’est la prière.
De nombreux adeptes se marient au sein du groupe. « Former un couple pour Kozen Rufu », signifie que la cellule familiale sert de relais pour la propagation de la doctrine. Un couple qui vit et éduque ses enfants selon les principes de la Soka Gakkai serait la clé d’une vie familiale réussie.
Les principes du groupe sont inculqués aux enfants dès leur plus jeune âge. Pour Daisaku Ikeda, « l’idéal est d’élever les enfants pour qu’ils chérissent notre organisation. Avec cet esprit, ils se développeront remarquablement.» Ils doivent également participer à l’action de prosélytisme . Dans cette optique, la Soka Gakkai a créé des départements jeunesse pour les former au « Kozen Rufu ».
Sur le plan politique, le but de la Soka Gakkai est d’instaurer une paix mondiale, et le chemin proposé pour y accéder est l’acceptation du bouddhisme de Nichiren Soshu par toute la planète. L’établissement d’une religion mondiale servant de base spirituelle permettrait d’aboutir à la création d’un état mondial idéal.
La paix dans le monde est l’un des thèmes de base de la campagne de communication mise en place par la Soka Gakkai dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale. Afin de cultiver cette image, elle s’appuie sur l’ONU dont elle est une ONG, comme d’autres grands mouvements sectaires, et elle finance des projets culturels et éducatifs.
Daisaku Ikeda a également rencontré de nombreux chefs d’états, ce qui lui sert de caution et le pare d’une aura d’honorabilité et de respectabilité auprès du public et des adeptes.
Riche et puissante, la Soka Gakkai tire une partie importante de ses revenus des dons. Les autres ressources sont d’origine commerciale: presse, vente d’objets de culte, de concessions et de monuments funéraires…
J'ai mis en gras tout ce qui peut détonner.
Commentaire :
Le Bouddha a dit clairement que : les prières sont vaines, les rituels inutiles, que la recherche de la prospérité matérielle en ce monde pour elle même ne peut mener à un bonheur profond et durable.
Le Bouddha s'est aussi opposé au culte de sa personne, puisqu'il a conclu son existence terrestre en disant : prenez refuge en vous-même. Donc l'ultime refuge ne peut être que l'introspection, c'est par elle qu'on atteint le but fixé par le bouddhisme, non dans la dévotion a un objet extérieur.
Et le Bouddha n'exhausse pas les prières. Ce n'est pas un dieu.
Le Bouddha refusa aussi toute fonction politique, ne créa aucun parti politique, et encouragea à questionner ses propres enseignements, à ne surtout pas le considérer comme vérité absolue comme émanant de Lui. Le Bouddha a aussi dit que l'examen personnel, l'expérimentation personnelle de ce qui est correct car menant et bonheur et incorrect car menant à la souffrance, devait primé sur tout texte fut-il sacré ou de réputation sacrée.
Le bouddhisme fut missionnaire (a partir de l’empereur Ashoka) mais jamais prosélyte. Le Bouddha n'a jamais dit qu'un pratiquant gagnait quoi que ce soit à faire des convertis. En toute logique une telle attitude - le prosélytisme - ne peut que renforcer le "Moi", l'illusion du "Moi", par de l'auto-satisfaction, de la fierté, de l'orgueil....
Le Bouddha durant sa vie (et il est le modèle de tout bouddhiste) évita consciencieusement et sciemment certaines régions et villes car il savait qu'il serait mal reçu car la population locale était trop attachée au brahmanisme. Il n'allait pas au devant des gens pour critiquer leurs doctrines mais les laissait venir à eux et répondait à leurs questions. Ce qui est le contraire même d'une attitude prosélyte.
Dans une pratique correcte du Dharma du Bouddha l'on commence par l'expérimentation sincère, on teste et c'est en vérifiant l'efficacité de la méthode du Bouddha parce qu'on gagne en bonheur dans la vie, qu'on peut alors développer la "foi" en le Bouddha, foi étant ici compris dans le sens de confiance. Ce qui est logique. Plus l'on peut vérifier par soi même que ce que quelqu'un vous dit est vrai, plus l'on a confiance en ce qu'il dit. Donc placer la foi (aveugle ?) en premier est en contradiction avec l'état d'esprit d'un pratiquant du Dharma du Bouddha.
Et le Bouddha ne récompensa jamais ses fidèles quand ceux-ci ramenaient de nouveaux fidèles. Le Bouddha ayant déjà tout ce qu'il était possible de souhaiter, il n'y gagnait rien.
Le Bouddha à ma connaissance n'a jamais non plus encouragé à se marier entre pratiquants de sa voie. Un pratiquant correct ne doit justement chérir personne en particulier ! Et surement pas une organisation financière et politique. Un pratiquant correct doit développer un amour et une compassion égale pour tous les êtres sensibles peu importe leur sexe, leur couleur de peau, leur religion, leur orientation politique, etc...
Le Bouddha n'a jamais utilisé d'enfant pour convertir autrui.
Ce qui a le plus servi au Bouddha fut sa propre attitude vertueuse. Il entendait être l'exemple parfait vivant de ce qu'il conseillait de faire.
En son temps l'empereur indien Ashoka développa pour la 1ère fois de l'histoire une sorte de bouddhisme d'état, tout en étant tolérant avec les autres traditions religieuses locales. Il fut très actif en faveur du bouddhisme. Tellement qu'après sa mort, il y eu un retour de bâton des brahmanes.
Le Bouddha refusa tout paiement en échange de son enseignement. Il le donnait à qui voulait l'entendre et acceptait parfois des dons quand on lui en faisait. Surtout des terrains pour sa communauté, des édifices légers pour se protéger pendant la saison des pluies , ainsi que des robes pour ses moines. Des dons en nourriture aussi forcément puisqu'il vivait en totale dépendance du bon vouloir des gens.
Tout ce qui est dit ci dessus est vérifiable dans des sources correctes de la part d'auteurs compétents.