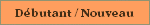pauline.px a écrit :Si je change le mot "pensée" par "digestion" on obtient un autre organe. Ici, vous définissez donc le cerveau à partir du concept de "pensée".
Jusqu’à présent, si j’ai bien compris, vous définissiez la pensée comme l’activité du cerveau.
D’où il ressort que cette objectivation consiste à objectiver le cerveau comme l’organe du corps dont l’activité correspond à l’activité du cerveau.
Non. Cette phrase ne correspond pas à une objectivation du cerveau d'une part et de la pensée d'autre part, elle consiste en une affirmation scientifique identifiant l'activité du premier à l'exercice de la seconde.
Je n'ai jamais dit que cette phrase était une phrase de définition, mais un fait scientifiquement prouvé.
Tout comme E=mc² d'Einstein n'est pas une définition de l'énergie, de la masse, de la célérité de la lumière ou de la fonction de puissance.
pauline.px a écrit :Faites comme il vous plaira, tout ce que je peux dire c’est que je n’ai vraiment rien compris à l’irruption de cette notion de point de vue pour donner de la consistance à votre concept de « pensée ». [...] Je comprends que Vicomte définit l’objet « pensée » exclusivement comme manifestation de l’activité du cerveau humain, je comprends son point de vue mais je ne vois pas bien en quoi son point de vue est pertinent.
Mais il ne s'agit pas de
mon point de vue ou du vôtre, il s'agit du point de vue de l'assertion. Qu'on le veuille ou non, toute assertion suppose une position, même lorsqu'elle n'est pas définie, c'est-à-dire, pour employer la terminologie de Quine, un référent de signifiance.
Vous ne pouvez pas dans une même phrase commencer par travail de table rase dans le champ de la logique (point de vue : le sujet connaissant dans son entreprise de connaissance à partir de son expérience propre), puis considérer un résultat scientifique (point de vue : la communauté des sujets connaissant dans leur entreprise à partir de l'expérience objective) tout en critiquant les lacunes de l'un à l'aune du point de vue de l'autre. Ça ne fait pas de sens.
En revanche, se servir d'un référent de signifiance (si vous préférez ce terme à "point de vue") pour donner sens à une assertion importée depuis un autre référent de signifiance (comme je le fais en me servant d'un résultat scientifique pour envisager, d'un point de vue extérieur, en quoi consiste l'exercice individuel de connaissance) cela devient pertinent me semble-t-il dès lors où il n'y a pas de confusion l'un avec l'autre.
pauline.px a écrit :
Pour l’instant, c’est l’objectivation de la "pensée" et celle du "cerveau" qui semblent liées, mais j’ignore tout du lien.
Alors je vous l'apprends : la science a mis en évidence ce "lien".
pauline.px a écrit :Par ailleurs, j’ai l’impression que vous confondez « pensée » et « activité d'un cerveau ».
La curiosité est que la « pensée » n’est pas objectivable par un électro-encéphalogramme à moins d’admettre que la pensée humaine est exactement de la même nature que la pensée d’une mouche. Tant que des neurones fonctionnent, prétendez-vous qu’il y a "pensée" ?
C'est plutôt vous qui confondez un électro-encéphalogramme et l'activité du cerveau.
Et effectivement, la pensée humaine est exactement de la même nature que la pensée d’une mouche. Seul le degré de complexité change, lequel aura des effets mesurables en termes de performances. La science l'a prouvé.
pauline.px a écrit :Aaaaah… enfin quelques traits d’objectivation de "pensée"...
Les aspects "anticipation" et "planification" sont intéressants : la chute des feuilles anticipant les rigueurs de l’hiver témoigne-t-elle de la pensée de l’arbre ?
La chute des feuilles anticipant les rigueurs de l'hiver est un processus représentationnel qui a téléonomiquement émergé à partir du système "arbre", lui permettant de survivre en anticipant le comportement de son environnement (ici, les variations de température et d'humidité).
L'arbre de "pense" pas, mais la pensée est également un processus représentationnel qui a téléonomiquement émergé, mais à partir d'un autre système, le "sujet humain".
pauline.px a écrit :J’imagine volontiers que dans l’évolution d’une espèce les mutations étant aléatoires donc certaines ne s’avèrent pertinentes qu’après une modification de l’environnement, s’agit-il une fausse anticipation malgré son succès ?
Plus exactement, le terme "anticipation" est malheureusement anthropomorphique. Il faut bien comprendre que toute finalité apparente est en réalité téléonomique (au moins par défaut, la charge de la preuve revenant bien évidemment à celle ou celui qui affirme qu'il s'agit d'une finalité décisionnelle).
pauline.px a écrit :Dès lors, l’évolution d’une espèce n’est-elle pas la "pensée" de l’espèce ?
Si l'on entend "pensée" de manière extensive, c'est-à-dire un processus représentationnel qui a téléonomiquement émergé à partir du système "espèce", oui.
pauline.px a écrit :Et pour paraphraser Hégel : D.ieu, béni soit-Il, n'est-Il pas la pensée de l'Univers ?
Si l'on entend "pensée de l'univers" un processus représentationnel qui a téléonomiquement émergé à partir du système "Univers", alors il existe une telle chose. Mais lui coller l'étiquette "Dieu" ne fait que le
nommer et ne rend pas vraies les assertions suivantes : il est doté d'une intelligence, il est personnel, il est omniscient et omnipotent, il espionne les humains dans leurs moindres faits et gestes et se met en colère lorsqu'ils font certaines choses avec leurs organes génitaux, etc.
pauline.px a écrit :
Le système neuronal est-il seul à être actif dans la "pensée" objectivable comme pensée et non pas comme activité du système neuronal ?
Pouvez-vous balayer d’un revers de main toute perspective de collaboration entre mon cerveau et son environnement au sens le plus large dans le processus de ma "pensée".
Je n'ai jamais dit de telles choses. Dans la plupart des cas il suffit de considérer le système "cerveau" seul, en considérant comme entrées les stimuli sous forme de cascades de décharges provenant de son activité interne ou des organes sensoriel, accompagnés des variations biochimiques provenant des différents organes (en particulier les cellules gliales) et quelques autres phénomènes (dont certains effets magnétoélectriques dus aux décharges neurales simultanées), et en considérant en sortie tous les "ordres" donnés aux organes et aux muscles (sous forme électrochimique principalement).
Mais parfois il n'est pas pertinent de procéder ainsi, lorsqu'on s'intéresse plus particulièrement aux influences externes. Parfois il est intéressant de considérer, par exemple, les écrits fabriqués par le sujet comme une certaine forme d'extension de son cerveau. Mais ça nous mènerait trop loin par rapport à ce dont nous parlons ici, me semble-t-il. Il suffit juste de se rappeler qu'en aucun cas la pensée peut s'affranchir du cerveau ni d'un quelconque support matériel que ce soit.
pauline.px a écrit :Par exemple : Comment expliquez-vous les idées nouvelles ?
Par l'exercice constant de l'activité cérébrale qui, effectivement, tire profit de l'expérience.
pauline.px a écrit :
Voilà bien un curieux sophisme !
Le fait de savoir que si la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil est vraie alors le grand théorème de Fermat est vrai n’a pas exempté Andrew Wiles de démontrer cette conjecture.
Wiles n’a pas dit « prouvez-moi que la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil est fausse ! En attendant le théorème de Fermat est vrai ! »
Au plan logique, le théorème « Si A est vrai alors B est faux » est équivalent à « Ou bien A est faux ou bien B est faux » je ne vois pas pourquoi l’ignorance au sujet de A aurait plus de valeur que l’ignorance au sujet de B.
C’est vous qui voulez prouver, c’est à vous de prouver que A est vrai.
Excusez-moi, mais votre réfutation n'a aucune rigueur logique.
J'ai dit, et je répète, que
si ma démonstration (page 1) est vraie, alors on peut opérer la réduction logique suivante : si le cerveau est bien l'organe de la pensée, alors dieu n'existe pas. Traduction : on considérant comme vrais tous les autres points par ailleurs, la valeur de vérité de "Le cerveau est l'organe de la pensée" détermine la valeur de non-vérité de "Dieu existe".
pauline.px a écrit :En attendant, vous pouvez considérer que votre conjecture est vraie jusqu’à preuve du contraire mais je ne vois même pas comment vous pouvez la justifier.
Ce n'est pas une conjecture, c'est une démonstration. Personne n'en a encore réfuté le moindre point, me semble-t-il. Tout au plus certaines personnes ont contesté certains points. Mais je n'ai encore eu droit à aucune contre-démonstration en règle, à une seule exception : Tan, qui, avec plus ou moins de rigueur, a montré effectivement que ma démonstration s'effondrait si le cerveau n'était pas l'organe de la pensée. Il a pour cela produit des expériences scientifiques qui, selon lui, démontraient que le cerveau était le "récepteur" de la pensée mais que celle-ci appartenait à un autre monde. Cependant une approche critique de ce qu'il a produit a, je pense, montré qu'elles n'étaient pas probantes.
pauline.px a écrit :Comment démontrez-vous l'inexistence de toute collabration entre mon cerveau et autre chose pour la "production" de ma pensée ?
Je n'ai jamais rien affirmé de tel. Le cerveau a constamment besoin de glucose, d'acides aminés, etc. mais également de fonctionner continûment en vase clos, mais également de réagir aux signaux qui, de proche en proche, ont trouvé leur source en dehors de lui. Ce qui n'empêche pas qu'en tant que système représentationnel, il soit pertinent de le considérer comme autonome.