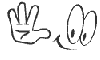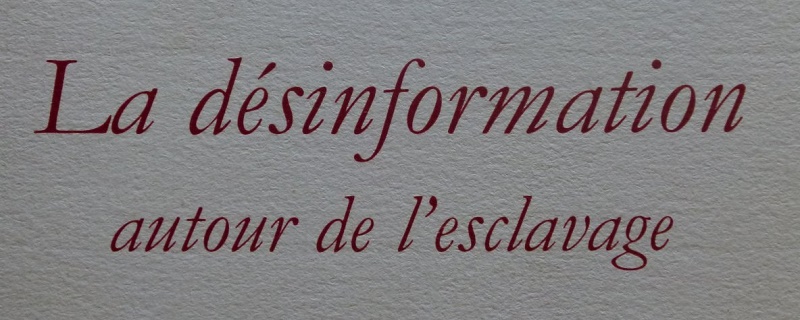
RAFFARD DE BRIENNE A., « La désinformation autour de l'esclavage », Atelier Fol'fer, coll. « L'étoile du berger », Paris, 2006, 100 p.
Si la « La désinformation autour de l'esclavage » que nous présentons aujourd'hui est assurément un livre d'une petite taille (une centaine de pages écrites en grands caractères), il demeure cependant d'une utilité et d'une densité intellectuelle tout-à-fait remarquable, si bien que nous ne puissions guère passer à côté.
D'une part, il s'agit premièrement pour l'auteur de parer aux idées reçues concernant l'esclavage. D. Raffard de Brienne se plaît ainsi à évoquer pour l'exemple plusieurs faits historiques niés, occultés ou oubliés, en tout cas relégués dans l'ombre de l'histoire enseignée ; sont ainsi alternativement présentés « l'oubli » historique des traites arabo-musulmanes qui, précédant de près d'un millénaire la traite transatlantique pour perdurer jusqu'au XXe siècle et remportant la bagatelle des 17 à 18 millions de victimes, soit près du double des traites européenne, firent l'objet de bien peu ou prou d'études et de vulgarisations à grand public, ou encore l'omission médiatique des traites internes à l'Afrique, c'est-à-dire de Noirs razziant, capturant, asservissant et vendant d'autres Noirs, puissant phénomène sans lequel les traites transatlantiques et arabes n'auraient jamais pu avoir un tel essor, et qui, faisant près de 14 millions de malheureux dans l'histoire, ne sont décidément pas de celles sur lesquelles Christiane Taubira se plaît à s'appesantir.
Mais quoi qu'il en soit, il est un fait que l'auteur ne s'arrête pas là : car son livre possède en effet d'autre part pour but de montrer qu'il y a eu sur le sujet une véritable volonté de désinformer. Et ce sera tout le génie de l'auteur que de démontrer avec de nombreux exemples plus pertinents les uns que les autres que cette omission de tout un pan de l'histoire de l'esclavage ne doit décidément rien au simple hasard. Le phénomène, curieux s'il en est, présente en effet l'indiscutable aspect d'une véritable désinformation, d'une ampleur à dire vrai assez peu croyable dès lors qu'on découvre avec effarement le nombre de victimes et l'étendue spatio-temporelle de ces traites, délibérément occultées et oubliées par l'historiographie officielle et par les pontifes de la bien-pensance. « À la lumière de ce qui précède », s'étonne ainsi candidement l'historien Murray Gordon cité par l'auteur, « on ne peut que être troublé de ce que le commerce des esclaves, tenu par les musulmans, ait été relégué dans un coin obscur de l'historiographie. » Le médiéviste français Jacques Heers était plus sévère : « C'est de propos délibéré, consciemment, » confirmait-il dans son ouvrage portant sur l'esclavage arabo-musulman, « que les auteurs se sont alignés sur des schémas conventionnels, modèles de discrétion. Certains y ont mis bien de la naïveté, ou l'ont fait croire, mais d'autres beaucoup de mauvaise foi, allant jusqu'à taire ce qu'ils savaient évident ou faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. »
S'il est juste de constater que l'esclavage fut une constante dans l'histoire de l'humanité, toutes civilisations confondues, on ne peut que s'interroger avec l'auteur sur le parti pris de l'intelligentsia à sélectionner, travailler et étaler devant tous, et ce au détriment de la simple honnêteté intellectuelle, le cas seule de la traite transantlantique, provoquant par là-même chez les esprits concernés une profonde repentance sinon même un malaise et une culpabilisation infuse, qu'elle soit consciente ou non.
Car que l'on ne s'y méprenne pas ! Une présentation aussi biaisée et faussée de l'histoire, inlassablement enseignée et répétée jusqu'à devenir une doxa commune ancrée en toutes les têtes, devient, pour reprendre les mots de l'auteur « intolérable, et ne peut demeurer sur le long terme, sans conséquence, par les sentiments de doute de soi et la démobilisation qu'elle induit. » (p. 94). Directement cause du sapement d'identité et de fierté nationale, un tel poison est facteur du phénomène ethno-masochiste, certes tant décrié mais que malheureusement également tant observé, de plus en plus dans nos sociétés européennes contemporaines, se manifestant dans cet état de délabrement mental et de haine de soi si génialement intitulé par Louis Pauwels « sida mental ». « Quel implacable occupant nous impose à ce point une si noire vision de notre passé ? » se questionne avec intérêt l'auteur à la fin de son étude. Qui sont ces personnes qui semblent motivées par une haine et un désir de souillure de notre patrie, « tant les ouvrages scolaires ou de vulgarisation semblent écrits par des ennemis de la France » (p. 96) ? Nous pourrions trouver un élément de réponse en se demandant à qui profite le crime. La réponse, évidente, est finalement fournie par l'auteur à la conclusion de son ouvrage : cette présentation constamment négative de notre histoire, pas plus fortuite que gratuite et représentant le mythe fondateur de la société multiraciale et pluriculturelle, sert principalement les forces mondialistes qui ont intérêt, « à coup de lois liberticides, de commémorations culpabilisantes et de falsifications historiques » à saper les identités nationales afin de parachever la mondialisation des peuples, des cultures, et l'uniformisation de la masse.
Il nous apparaît cependant regrettable que D. Raffard de Brienne ne nous offre, à ce stade de l'ouvrage, quelques pistes pour comprendre quels sont les origines, les ressorts et les fondements religieux de ce mondialisme idéologique. Toutefois, il convient de rappeler que tel n'est pas initialement l'objet de l'ouvrage : s'agissant en effet de démontrer la volonté de désinformation systématique autour de l'esclavage, et de rétablir quelques vérités historiques occultées, nous ne pouvons demander à l'auteur d'écrire sur ce dont il ne doit traiter. En tout cas, nous avons personnellement beaucoup apprécié cet ouvrage, dont l'utilité première reste le « décrassage » intellectuel de ce que la bien-pensance au complet – médias, éducation nationale, politiques, etc – nous rabâche interminablement, et la démonstration d'une volonté même de présenter une sombre vision de l'histoire de France, et faisant, de faire culpabiliser son peuple. Nous le conseillons avec insistance à tous, d'autant que le livre est très court et peut se lire en une heure.
Citations proposées :
- « Même si le malheur humain ne peut se quantifier et si l'évocation comparative du nombre de victimes peut sembler incongrue ou un peu déplacée, on ne peut comprendre l'ampleur de la désinformation autour de l'esclavage si l'on n'évoque pas le nombre de victimes de chacune de ces trois traites. Leur ordre de grandeur. Les traites européennes déportèrent environ 11 millions de captifs. Les traites internes africaines portèrent sur 14 millions de Noirs et les traites arabo-musulmanes plus de 17 millions d'Africains et d'Européens. [...] L'incroyable silence, à peine rompu, et encore, de façon très marginale, concernant les 31 millions de victimes des traites arabes et africaines semblera inouï d'ici quelques années à tous ceux s'intéressant à la question. », pp. 21, 23-24.
« Pour résumer, l'homme occidental développa l'esclavage plus tardivement, l'arrêta plus tôt et le fit porter sur moins d'Africains que les Arabes. Il fut de plus le seul promoteur et garant sévère de l'abolitionnisme et c'est pourtant à lui seul que certains voudraient faire porter le fardeau d'une repentance publique et perpétuelle d'ailleurs officialisée depuis peu par une journée de commémoration annuelle dont la première se déroulera le 10 mai 2006. », p. 14-15.
« Nos pudiques historiens omettent aussi bien souvent de mentionner que dans les Amériques, aux premières heures de la traite transatlantique, les Blancs furent aussi nombreux que les Noirs à être déportés et qu'au début du XVIIe siècle, les planteurs du Nouveau monde employèrent indistinctement Européens et Africains dans leurs plantations, les deux communautés partageant de 1619 à 1660, rigoureusement le même statut. [...] Un voile pudique est jeté sur cette traite des Blancs qui fit pourtant plusieurs millions de victimes selon l'historien américain Robert Davis, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Environ 1 million à 1 250 000 Européens pour la seule période comprise entre 1530 et 1780 – période de forte activité barbaresque en Méditerranée et dans l'Atlantique – furent enlevés de force au cours de razzias sur les littoraux italiens, français, espagnols, siciliens, corses ou aux cours des innombrables actes de piraterie en Méditerranée et dans l'Atlantique. La tête de prisonnier maure servant d'emblème à la Corse témoigne en souvenir des terribles combats livrés contre les barbaresques. », pp. 43-44, 45.
« Ceci dit, la culpabilisation permanente de l'homme occidental et de lui seul, dans le regard qui lui est imposé de son passé, devient intolérable et ne peut demeurer sur le long terme, sans conséquence, par les sentiments de doute de soi et la démobilisation qu'elle induit. Moins d'une semaine après avoir annoncé la suppression de l'alinéa 4 de la loi du 23 février 2005 consacrant le « rôle positif de la colonisation française », le président de la République, Jacques Chirac, annonçait l'instauration, chaque 10 mai, en France métropolitaine d'une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Cette double décision du chef de l'État, en moins d'une semaine, l'une refusant la reconnaissance officielle d'un bienfait accompli par notre pays et l'autre imposant une commémoration de maux dont nous ne fûmes ni les initiateurs, ni les plus coupables, se passe de tout commentaire tant elle résume à elle seule l'état de délabrement mental et de haine de soi qui a atteint nos contemporains. Ainsi les besogneux du devoir de mémoire auront obtenu gain de cause et chaque année, l'on pourra ressasser, à grands renforts de cérémonies et d'allocutions, la grande culpabilité de l'homme occidental, blanc, français et européen et de lui seul, dans l'esclavage. Car il n'est bien entendu pas question, à ce jour, d'honorer les victimes des traites africaines et musulmanes, jugées secondaires et constamment minimisées, pas plus que de commémorer l'abolition de celles-ci. Peut-être simplement pour ne pas fâcher l'homme de couleur envers lequel nous aurions contracté une dette inextinguible. », pp. 94-95
![[Modérateur] [Modérateur]](./images/ranks/pic_moderateur.gif)