estra2 a écrit :
Bon, évidemment, si on part du principe qu'on ne fait aucun choix et qu'on n'est pas une personne, il n'y a rien à examiner, rien à quoi se confronter... à partir de là, parler d'être honnête avec soi-même n'a plus aucun sens puisqu'il n'y a pas de "soi-même"

Tout à fait.
__________
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 06:35
Dans l'éveil spirituel, on ne part d'aucun principe, car tout principe est par définition conceptuel, et donc intellectuel.
Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec toi.
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 06:35
Les principes que nous énonçons ne sont que la conséquence de l'éveil spirituel, et aucunement la base ni la cause.
Donc un éveillé peut se tromper en concluant à de faux principes ?
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 06:35
J'ai affirmé plusieurs fois que l'affranchissement des croyances est caractéristique de l'éveil spirituel, et que "c'est la base".
Si s'affranchir des croyances c'est la base de l'éveil spirituel, alors ton éveil est foireux. Car dans ton cas, non seulement tu t'accroches de manière acharnée à certaines croyances bien qu'on te montre leur caractère incohérent, mais qui plus est : tu en adoptes de nouvelles !
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 06:35
Cela ne signifie aucunement qu'il faille s'affranchir de toutes croyances pour enfin s'éveiller.
Pas du tout.
Certaines de tes croyances sont pourtant inconciliables avec un éveil spirituel véritable.
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 06:35
Donc pour l'exemple du libre-arbitre, il y a d'abord l'éveil qui se produit, et c'est seulement ensuite qu'on prend profondément conscience que le libre-arbitre était une illusion.
Non, si tu le conclus, c'est une erreur.. Et ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle croyance que tu ajoutes à ton lot de croyances, parce qu'elle t'arrange bien.
Ne mêle pas l'éveil spirituel à tes affirmations subjectives et creuses sur la base d'une définition biaisée de quelque chose dont tu n'as pas l'intelligence.
De plus, tu déclares que le libre-arbitre n'existe pas et que tu ferais l'expérience de cette inexistence.
C'est juste un non sens total. On n'expérimente jamais une non expérience..
Enfin, je l'ai déjà mentionné de nombreuse fois, mais une erreur et une illusion sont deux choses différentes. Toi tu confonds les deux.
Par ailleurs, on ne voit pas le caractère illusoire d'une expérience perceptive, on le comprend. Or, le comprendre n'est pas en soi une expérience.
__________
ronronladouceur a écrit : ↑05 déc.24, 06:51
Apport de L'IA :
Points de convergence entre vacuité et ouverture pure
Déconstruction des illusions : Les deux concepts invitent à déconstruire les illusions construites par l'esprit et à voir la réalité telle qu'elle est.
Croire voir (ou pouvoir voir) la réalité telle qu'est, c'est en soi précisément une construction de l'esprit et c'est une erreur.
ronronladouceur a écrit : ↑05 déc.24, 06:51
Nature non-duale de la réalité : Tant la vacuité que l'ouverture pure pointent vers une réalité non-duale, où toutes les choses sont interdépendantes*.
Ce n'est pas entièrement faux, mais c'est mal dit. Déjà parce qu'une "ouverture pure", il faudrait un peu mieux préciser ce que tu entends par là.
Ensuite, la vacuité ou ce que certaines écoles bouddhistes nomment ainsi, ne pointe pas vers une réalité non-duelle pour la bonne raison qu'elle est non-duelle.
En effet, croire pointer quelque chose de non-duel ou croire que telle ou telle chose ou attitude pointerait vers une réalité non-duelle est pour le moins paradoxal, dans le sens que cela instaure précisément une dualité entre ce qui serait pointé et cela même qui est censé le pointer.
Croire qu’un propros ou une attitude puisse pointer vers une réalité non-duelle est en soi une contradiction. Cette croyance instaure une séparation entre ce qui pointe (le moyen) et ce qui est pointé (la non-dualité), ce qui revient à maintenir une dualité. La non-dualité, par essence, ne peut être atteinte par un acte ou un processus qui divise. Toute tentative de "pointer vers" implique de recréer la structure dualiste que l'on cherche à transcender.
>>>>> Vouloir pointer vers la non-dualité, ou croire le faire, revient à la nier.
ronronladouceur a écrit : ↑05 déc.24, 06:51
* L'avantage de cette conception, c'est qu'on ne fait pas l'économie de la réalité...
Oui, concevoir la vacuité comme l'interdépendance elle même, autrement dit : comprendre que rien n'existe qu'en relation à autre chose, évite bien des erreurs.
___________
ronronladouceur a écrit : ↑05 déc.24, 11:08Tenez, pour faire court, j'avais aussi questionné l'IA...
Conclusion...
''En définitive, l’unité des déterminismes internes et externes montre que tout phénomène, y compris les actions humaines, est intégralement conditionné. La complexité des interactions entre ces déterminismes ne laisse aucune place à une "liberté" qui échapperait aux lois causales. Plutôt que de concilier déterminisme et libre-arbitre, cette perspective révèle que la notion de liberté individuelle est une construction conceptuelle qui résulte de notre perception limitée de la causalité. Le libre-arbitre, dans un cadre strictement déterministe, s'effondre comme une illusion.''
gzabirji a écrit : ↑05 déc.24, 18:53
Absolument !

Sur ce coup-là, bravo l'I.A.!

Le problème c'est que vous vous fondez sur une définition biaisée car impossible du libre-arbitre, pour exclure sans examen et de manière circulaire un libre-arbitre mieux défini et compatibiliste, bien réel celui-là.
Le point n’est pas de nier que les déterminismes internes et externes soient profondément liés, interdépendants, et forment une unité cohérente. Il est évident que les déterminismes internes sont façonnés par les déterminismes externes. Mais l’inverse est tout aussi vrai : les déterminismes externes sont influencés et modifiés par les déterminismes internes.
L’erreur consiste à croire qu’il n’y aurait que des déterminismes externes, gouvernant entièrement les facteurs internes, ou qu’à l’inverse, les déterminismes internes seraient totalement autonomes et influenceraient unilatéralement les facteurs externes. Une telle vision réductrice ignore leur interaction complexe et bidirectionnelle.
Le véritable problème est que votre rejet du libre-arbitre repose sur une définition biaisée, irréaliste, qui exige une indépendance totale ou partielle de toute causalité. En adoptant cette définition impossible, vous écartez d’emblée la possibilité d’un libre-arbitre mieux défini, ancré dans une perspective compatibiliste. Ce libre-arbitre, bien qu’inscrit dans les déterminismes, demeure néanmoins réel et opérant. Votre raisonnement circulaire le disqualifie sans l’examiner véritablement.
[
Je pose ici une problématique fondamentale en philosophie : la tension entre déterminisme et libre-arbitre. En soulignant l'interdépendance des déterminismes internes et externes, je dépasse la vision dualiste ou unilatérale qui réduit l’un à la conséquence de l’autre. Cette interaction bidirectionnelle met en lumière la complexité des causalités humaines, remettant en question les approches simplistes qui dominent souvent le débat.
L’intérêt philosophique de mon propos réside également dans la critique d’une définition irréaliste du libre-arbitre, qui exigerait une indépendance partielle ou absolue vis-à-vis des déterminismes. Cette critique vise à déconstruire une caricature souvent utilisée pour rejeter le concept même de libre-arbitre. En revanche, j'invite à considérer un libre-arbitre compatibiliste, qui ne nie pas l’influence des déterminismes mais les intègre comme cadre au sein duquel des choix libres et conscients sont possibles.
Cette approche compatibiliste est significative : elle permet de réconcilier deux visions apparemment incompatibles, tout en répondant à des enjeux éthiques et existentiels cruciaux. Si le concept de libre-arbitre est reconstruit sur des bases réalistes, il permet d'en aborder la réalité opérante dans un monde déterminé, appuyant l'objectivité d'une responsabilité morale et celle d'une autonomie individuelle.
Enfin, ce raisonnement révèle une faille dans certains discours philosophiques ou scientifiques contemporains : le recours à des définitions biaisées pour invalider des concepts complexes. Il rappelle que l'attitude philosophique va de pair avec l'examen de ses propres présupposés et le fait de rester ouvert à des définitions nuancées et fécondes, surtout lorsqu’il s’agit de notions aussi fondamentales que la liberté et la causalité.
Ainsi, je ne me contente pas de réhabiliter le libre-arbitre : je pose une exigence méthodologique essentielle pour tout débat philosophique, en appelant à dépasser les caricatures conceptuelles et à embrasser la complexité. ]
__________
Une petite réflexion comme ça :
S'il n'existe aucun critère objectif permettant de caractériser l'éveil spirituel, alors une personne affirmant le vivre ne pourrait pas, même pour elle-même, confirmer ou reconnaître que ce qu'elle vit correspond réellement à cet éveil. En l'absence de tels critères, l'éveil devient une notion purement subjective. Se dire éveillé relèverait donc uniquement d'une opinion personnelle, qui ne serait justifiée que par le ressenti individuel, mais sans fondement objectif pour la soutenir. Par conséquent, une telle affirmation ne pourrait être autre chose qu’une croyance appliquée à une expérience dont la nature reste indiscernée.
.- La réalité est toujours beaucoup plus riche et complexe que ce que l'on peut percevoir, se représenter, concevoir, croire ou comprendre.
- Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas.
Humilité !
- Toute expérience vécue résulte de choix. Et tout choix produit sont lot d'expériences vécues.
Sagesse !

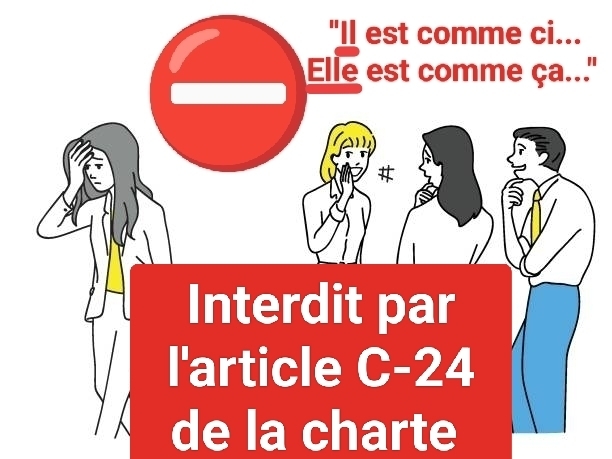
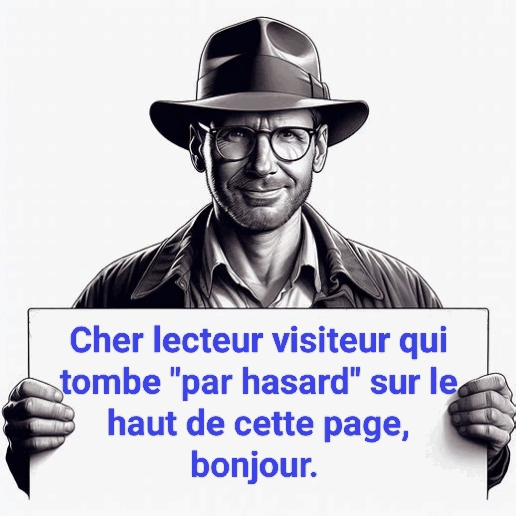
![[Modérateur] [Modérateur]](./images/ranks/pic_moderateur.gif)
